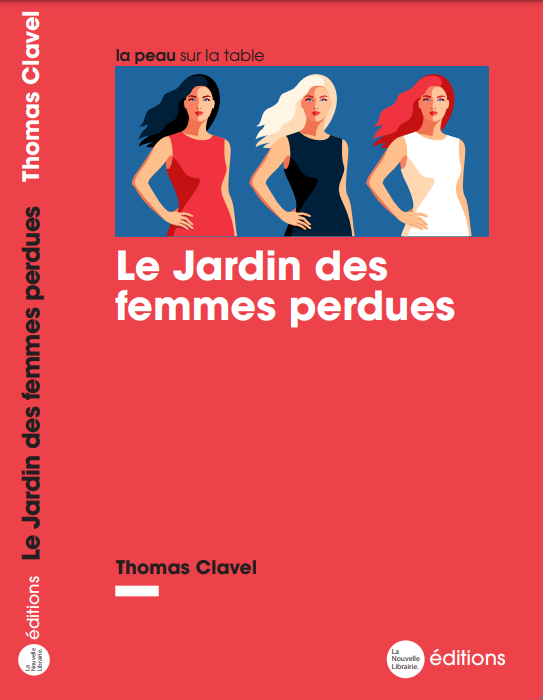

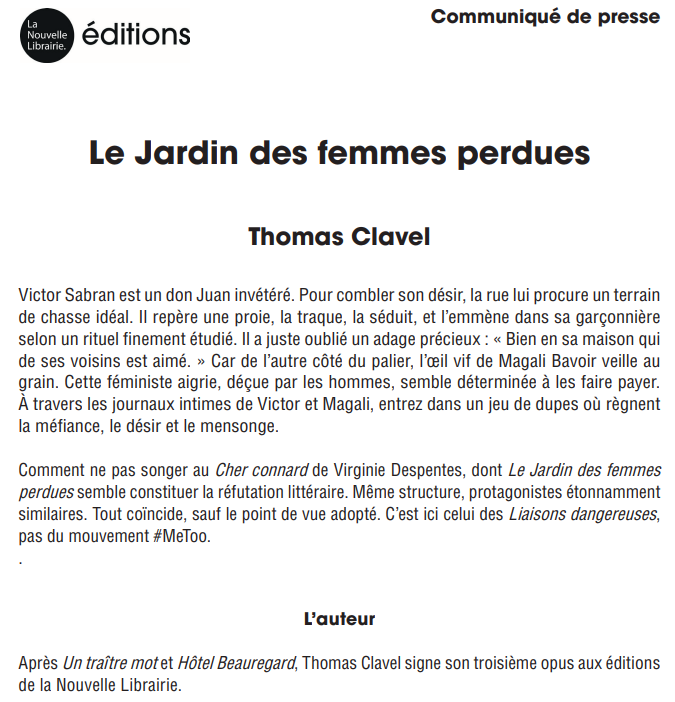






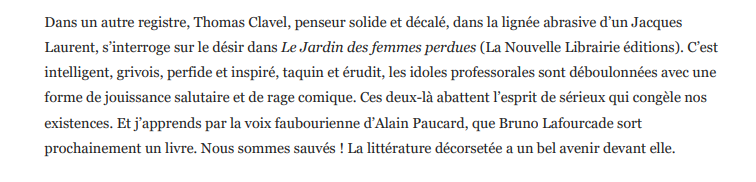


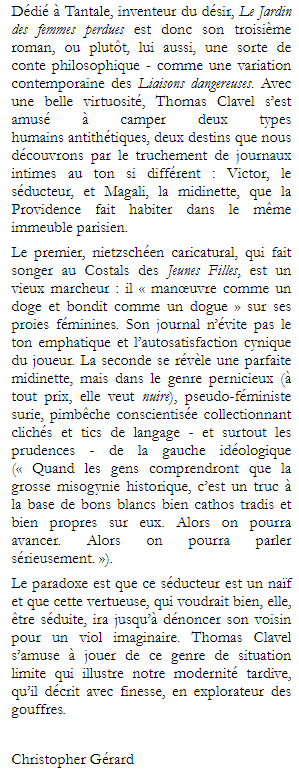

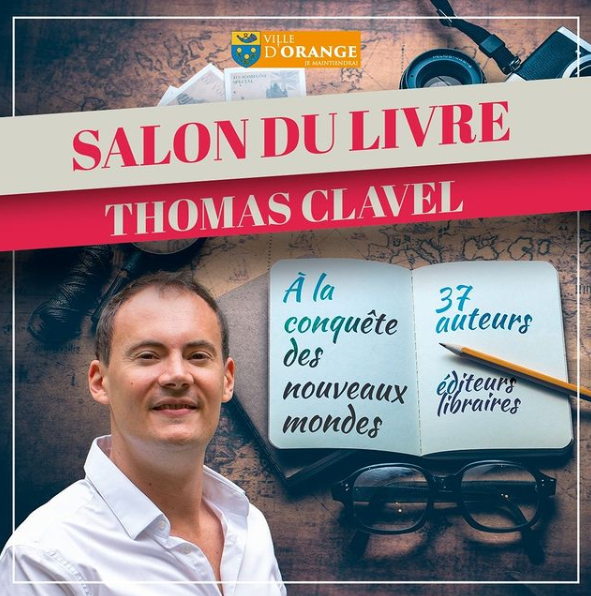

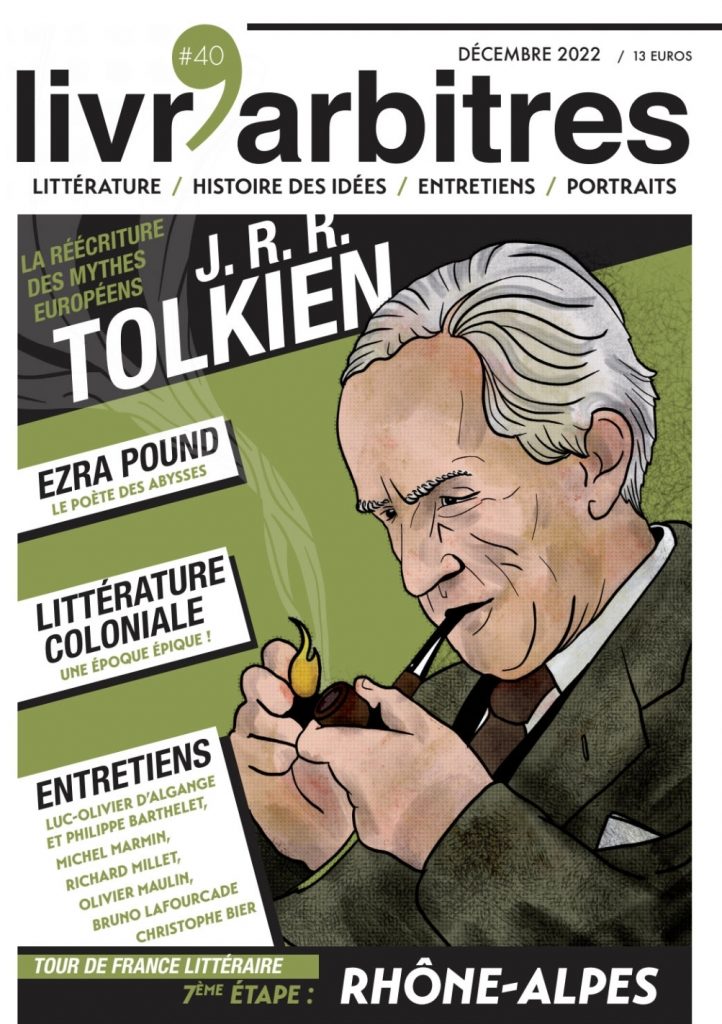
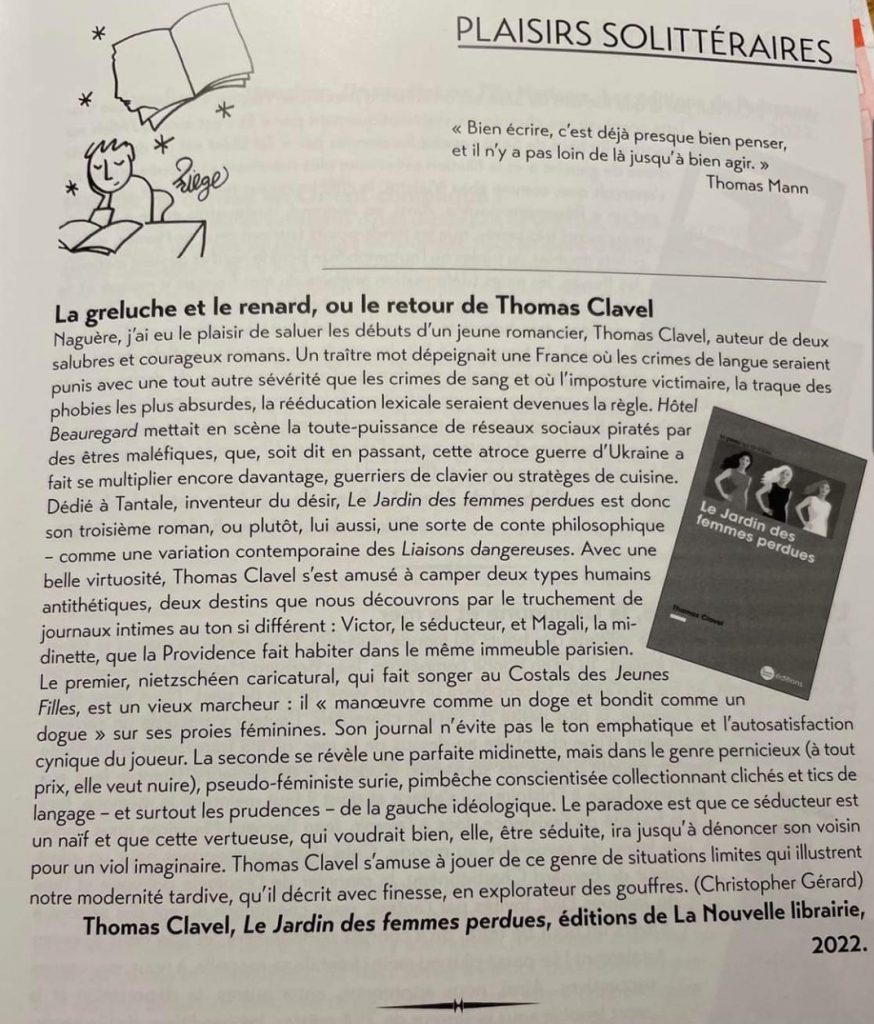

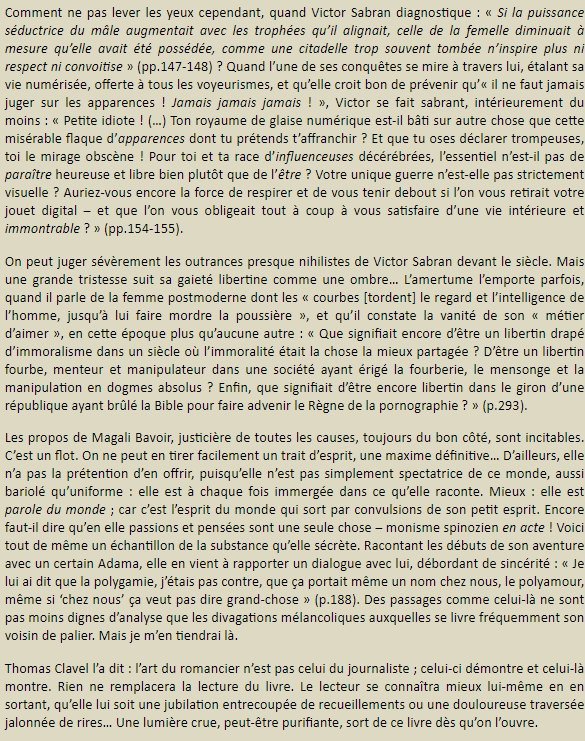
Le Jardin des femmes perdues de Thomas Clavel
Commenté par Jean Chibret, professeur de littérature en khâgne
Victor Sabran exerce « le doux métier d’aimer » : les femmes, les livres, la vie. Ce
« métier » est un jeu, c’est-à-dire action, mouvement et jouissance. Il exige
l’attention du chasseur, relève de la représentation théâtrale, constitue le
divertissement par excellence, « les grands joueurs » préférant la traque à la
proie ; c’est une quête autant qu’une conquête méthodique. Magali Bavoir porte
un nom infiniment parlant, anagramme de Bovary, et moitié de Beauvoir. Elle
exerce « le dur métier d’enseignante ». Ses échecs répétés en amour l’entraînent
dans la mouvance féministe radicale en lutte contre l’inégalité des sexes « dans un
enfer masculiniste à ciel ouvert ». Leurs deux récits alternent selon la loi du
contraste systématique : ici « le grand style », au sens nietzschéen, de vie,
d’écriture, de conduite ; là l’éthos populaire, aussi bien dans les manières de vivre
– « chips et sauciflard » – que dans les manières de dire – « ce gros vicelard » –
ou bien encore dans l’oralité d’un discours proliférant. Avec Victor, le jeu de la
séduction comme propédeutique à l’émerveillement ; avec Magali, le feu de
l’indignation. Voici la nouvelle guerre asymétrique des deux sexes.
La « prof d’arts pla » voit partout la violence sexiste : dans la salle de sport, dans
le métro coulent « des rivières de libido » ; au collège elle découvre « deux mecs
hilares » près de « deux jeunes nanas travailleuses » : la lutte des sexes a remplacé
la lutte des classes, avec son style Pravda mâtiné de Prada. Elle projette sur Le
Verrou de Fragonard une lecture féministe parfaitement anachronique pour
« déconstruire les préjugés » de ses élèves. Rencontrant son voisin Victor, elle le
décrit comme un déséquilibré, un « détraqué », un pervers ; « mon psychopathe,
mon taré de voisin, mon connard de tortionnaire de femmes » ; la gradation
dépréciative des désignations correspond à la montée de sa haine. Mais elle
portraiture impitoyablement les conquêtes de Victor. La haine des hommes
s’étend aux femmes qu’ils convoitent. Réalisant fantasmatiquement la scène du
Verrou au terme de son engagement, elle imagine son propre viol par Sabran.
Du collège à l’Université, les femmes occupent les postes d’autorité : les « deux
institutrices », « éducatrices » de La Sorbonne portent les « lunettes rouges
carrées » de la militante activiste Suffragette ; elles sont le prisme et l’emblème
idéologiques d’une vision du monde révolutionnaire et dogmatique qui transforme
l’Éducation en grande maison de correction, avec les mêmes méthodes
infantilisantes. Ce que Magali et Amélie appellent « transmettre », entendons
« endoctriner ». Violence faite à la langue autant qu’à la peinture, à l’école autant
qu’à la tradition, propagande propagée à toutes les jeunes femmes qui parlent la
langue du féminisme, « sa prose accidentée ». De « Vestales » les femmes sont
devenues « Bacchantes » : au lieu d’entretenir le « foyer », elles allument mille
« foyers » de rébellion pour assouvir « leur instinct de destruction ». Le
féminisme est un « virilisme » inversé ; il s’approprie toute la panoplie de la
violence pour assouvir sa vengeance : Victor est voué au destin d’Oreste poursuivi
par les Érinyes, d’Orphée massacré, d’un Saint-Georges terrassé par des femmes dragons « au regard identique, empoisonné ». Le féminisme est un paganisme, sur
fond d’antichristianisme profanateur : quand ses conquêtes lui apparaissent « en
Gorgones de fumée », chacune s’empare de la formule rituelle de la liturgie
catholique dans une inversion satanique : « Dis seulement mon nom et tu seras
guéri ». Aimer les femmes est un crime qui mérite expiation sans rédemption.
Aussi le séducteur coupable s’enfuit-il vers le Sud originel, virgilien et nervalien,
vers la campagne romaine chère à Poussin, en quête d’un Pausilippe – ce lieu « qui
fait cesser le chagrin » –, lieu de consolation après l’expulsion du « Jardin » où la
« perdition » des femmes entraîne la perte d’un monde heureux et lumineux, celui
de l’Italie, mère des arts et des lettres, de la musique et de la peinture. Victor est
le dernier Pâris chassé de ce Paris qui, à la Renaissance, voyait en lui l’origine de
son nom. Pâris appelé par Ronsard « Alexandre », le conquérant par excellence.
La disposition du « Carnet » et du « Journal » donne la priorité au regard de Victor
sur celui de Magali, même devenue « Maé ». Le libertin séduit le lecteur par la
clarté et la sincérité de son récit : le point de vue féministe apparaît alors choquant,
fortifiant la crédibilité du Carnet en accusant le délire du Journal. Ainsi
l’interprétation tendancieuse du Verrou par « la prof d’arts pla » est-elle invalidée
par le récit de Victor. Loin de violenter les femmes, Victor découvre qu’elles
viennent spontanément à son domicile, escortées parfois, comme Margaux, d’une
amie : elles le provoquent à l’amour. Si Clémence consent la première à accepter
son invitation, le récit de la scène est un clin d’œil au Verrou : « Prudemment, je
nous enfermai à double tour ». L’adverbe est l’antonyme de « violemment » ; le
pronom-complément « nous » écarte toute séquestration pour une connivence
parfaite dans le consentement. Quelques conquêtes plus tard, lorsque Clélie arrive
chez lui : « J’ouvris la porte – mais ce fut elle qui la referma à double tour ». Voilà
le conquérant conquis par sa conquête, surpris de cette audace de Clélie. Les deux
gestes sont aussi éloquents que le silence de la peinture ; par sa démarche, le
libertin libère la femme de sa réserve, en fait son égale, s’émerveille de cette
complicité heureuse. Victor est tout sauf « un sabreur », il est le véritable
« référent-consentement », une référence en matière de consentement. Le
« Carnet » est un commentaire en action du tableau, une rectification éloquente et
discrète des projections du féminisme et une critique des assertions dogmatiques
de Suffragette : « Le consentement véritable n’existe pas en hétérosexualité ».
Avec le Carnet les mots retrouvent leur acception plénière et le récit masculin en
reçoit du lecteur un coefficient de vérité – morale, intellectuelle, politique –
supérieur et exclusif.
La séduction est un art total, comme l’opéra. Le séducteur est le véritable maître
en arts plastiques ; il engage tout son corps : c’est une « gymnastique oculaire
subtile », une « chorégraphie des mains », une composition musicale exécutée par
un « pianiste virtuose », une danse, « ce combat héroïque du corps contre lui-même et ses plus bas instincts » ; c’est une ascèse où se mêlent la vie et la
philosophie : « Un grand séducteur n’est-il pas d’abord un grand questionneur ? ».
Comme Socrate, Silène mais accoucheur de vérité, la séduction peut choquer les
féministes, elle est un chemin vers le bonheur. À la virtuosité du pianiste, Victor
ajoute la « virtu » du prince machiavélien : « Manœuvrer comme un doge et
bondir comme un dogue », patience dans la résolution et rapidité dans l’exécution.
Si le jeu paronymique désamorce le sérieux de la formule pour l’ironie burlesque
envers soi-même, il rappelle la duplicité du prince, à la fois renard et lion ; séduire
est un art aristocratique, le séducteur un prince capable de donner à la Fortune la
forme d’une œuvre d’art, sur le modèle du sculpteur pour Aristote. Aussi chaque
aventure du Carnet s’achève-t-elle sur l’ellipse de la scène sexuelle, soit
mentionnée avec désinvolture (avec Sandrine : « j’expédiai l’affaire une semaine
plus tard »), soit sublimée dans une notation en clausule (avec Clélie : « je me fis
le savant chorégraphe de son corps enchanté). Voilà le valet passé maître, comme
dans les comédies de Marivaux, devenu parfait imitateur de la « petite danseuse »
dont l’audace l’avait ravi. C’est pourquoi les seules scènes sexuelles racontées
impliquent Maé Bavoir. Ainsi de sa « plainte » retranscrite dans son Journal :
« Victor Sabran entre et referme la porte derrière lui. Je pousse un cri et il me
bâillonne de sa main droite » ; la plainte est une parodie fantasmée du Verrou, le
symétrique inversé de la séduction de Clélie ; la séduction est volupté partagée,
l’accusation mensongère est jouissance perverse : « Quel jeu d’enfant ! Une vraie
partie de plaisir ! ». Le « coup du préservatif », une virtuosité sans « virtu », une
régression à un désir infantile qui refuse tout obstacle. L’amour heureux pour elle
ramène à la prime enfance – avec Adama, « on a dormi comme des bébés » –,
mais la troisième nuit, Adama néglige les précautions demandées par Maé et jouit
de son corps malgré elle. La scène n’est pas annexée à la « culture du viol »,
pourtant elle est l’envers du Verrou : indifférence du violeur, violence de la femme
violée, fuite en silence du coupable : « Je lui ai balancé un verre d’eau sur la
gueule… Mais il s’est levé et il est parti… Sans un mot ». Invitée chez Maé,
Suffragette y censure sa bibliothèque, expose sa théorie du lesbianisme, avec
l’autorité morale de l’intellectuelle aguerrie, puis impose à Maé une relation
homosexuelle non désirée : « Tout s’est emballé, je me suis laissé faire, comme
hypnotisée ». La féministe s’avoue victime d’une autre féministe, sans réprobation
ni indignation. Ainsi les proclamations vertueuses des féministes sont à géométrie
variable : elles omettent des viols et des violences réels pour mieux accuser
l’homme de viols imaginaires ; elles ne connaissent que deux camps : les femmes
victimes, les hommes blancs, bourreaux. Après sa plainte, Maé se réfugie chez le
violeur réel pour échapper au violeur imaginaire. Le féminisme préfère une vision
simplificatrice à une réalité tragique, dont seul le lecteur peut rétablir la vérité par
confrontation des points de vue et comparaison des discours.
C’est que Victor et Maé dialoguent malgré eux dans le roman : loin de s’opposer
radicalement, ils se complètent, la truculence de Maé assaisonnant par contraste
l’élégance de Victor, tous deux ayant la commune visée de séduire le lecteur autant
que de le persuader. La féministe est une séductrice, le séducteur un habile orateur.
Dans la conquête de Chiara, la belle Napolitaine, le « trio d’Espagnols » qui
l’escorte apparaît successivement comme « les Rois Mages », « Cerbère » avec
ses « six yeux noirs et globuleux », « trois sentinelles ibériques », « trois
Castillans », « trois gitans ». Ces sept désignations rappellent par leur fantaisie
l’art du portrait satirique, et par leur liberté vive, les Caprices de Goya. Maé
Bavoir use d’un procédé semblable lorsqu’elle présente les hommes comme des
« paires d’yeux », « des paires de couilles ». Victor est un picaro, comme Gil Blas,
il agit seul, sans allié ni ami pour débrouiller les fils de l’existence. Maé est aussi
seule : malgré les applications comme « Tinder », ce « Tendre » déboussolé, elle
voit les hommes qu’elle rencontre s’esquiver, se cacher derrière l’écran, comme
Adama se réfugie dans le silence pour échapper à ses discours assommants. Sa
conversion est une compensation de sa solitude ; mais dans son Journal, elle se
dédouble et, comme Victor admire son talent de séducteur, elle s’affranchit de la
prison militante pour se faire satiriste douée de bon sens et cibler l’isolement :
« Mais passez-moi un humain, bordel, même un illettré, même avec un accent du
bled », cibler aussi la dictature de la minceur qui condamne les rondeurs –
« perdre deux kilos de gras pour les faire fantasmer encore plus ? » La truculence
de son discours conquiert le lecteur par la crudité de ses formules neuves : « Les
mecs ont tous une bite à la place du cerveau, homo erectus, ça leur va bien à ces
bourrins des cavernes qui font luire leurs petits biceps de merde ». Ainsi se
dédouble-t-elle entre truculence et la langue de bois, la première, vivante,
enchantée, ridiculisant la seconde, ossifiée : « ça aurait de la gueule de lui tailler
ses petits joyaux, ses petits joyaux chéris ! Oui, il faut que la peur change de camp.
Et ça, c’est pas négociable. » Comme Victor elle se sent « un peu poétesse »,
proche de « potesses », comme le mot fétiche de Victor « prouesses » se
décompose dans la graphie « pro-e-s », calligramme involontaire d’une
langue débridée et en débris. L’un et l’autre sont sous le charme des mots : elle les
décomposant pour en déguster la pertinence – « Ac-ca-blant » –, lui les étirant
pour leur rendre leurs lettres de noblesse, « Mademoiselle ». Tous deux goûtant
les paronymies : « parquer et patriarquer », « déchiffrer » ; « défricher », et
s’étourdissant de la disparate énumérative ; elle : « Il faut ouvrir les yeux. Il faut
ouvrir sa bouche » ; lui : « Nous parlâmes gilets jaunes, bonnets rouges, tabac gris
et péril brun ».
Les deux personnages sont miroirs l’un de l’autre. Maé fait sienne la devise de
Victor, « Aime ce que tu hais » lorsque, livrant sans détour son « intuition », elle
s’avoue : « Oui, je sens qu’il me désire. Peut-être bien qu’il m’aime », au mépris
du bréviaire féministe et de ses interdits. C’est par dépit amoureux qu’elle se
venge, par jalousie de « ses pétasses qu’il fait défiler devant sa porte » ; sous
l’emphase militante, les passions les plus anciennes et les plus basses. Ainsi Victor
voit-il dans le féminisme l’hypocrisie d’une secte qu’il attaque comme Don Juan
les dévots. Mais Maé, militante, est aussi victime de ce féminisme qui l’aliène à
elle-même, éloigne les hommes d’elle, l’exile de son désir de bonheur stable et
partagé, comme elle le confie à Adama. Victor, si elle le lisait, l’aiderait à se
dessiller : il présente et décrit les jeunes filles comme des récitantes : Amélie qui
ne lui épargne pas son « sinistre couplet sur l’égalité des sexes », ses stéréotypes,
de langue et de vision : « On ne triche pas quand on joue ». Le séducteur exhibe
la facticité du discours des femmes sous influence du féminisme, autant que le fait
Maé en associant discours truculent et expressions figées. Aussi Amélie est-elle
aussi assommante pour Victor que Maé pour Adama. Mais, involontairement,
Amélie révèle à Victor le nihilisme du féminisme : « Le grand Mystère de la
femme ? Elle n’en contient aucun. Au galant donc d’enchanter l’historiette ». Aussi
se présente-t-il comme le gardien du féminin : il emploie le mot « pudeur » pour
éviter de nommer l’abjection du « coup du préservatif », il use de ce mot
originellement réservé aux femmes pour se faire l’avocat du féminin. Il cite
Merteuil et non Valmont. Il y a une morale de la séduction et une immoralité du
féminisme. Ce que le Journal de Maé confirme. Cette spécularité réciproque des
deux personnages montre la persistance et la permanence de la relation
traditionnelle. « Psychopathe » selon Maé, Victor se découvre « psychiatre » avec
Lou, en proie à la « fureur mythomaniaque », et se réfugie dans le jeu de rôles
traditionnels, opposant à « ses singeries un air de virilité paysanne et antique » ;
le voilà d’une gravité romaine par contradiction ; dans le chapitre suivant, avec
Corentin, « son deuxième rencard Tinder », Maé veut « lui proposer un jeu de rôle
en mode grandeur nature ». Ils se retrouvent dans leur commune démarche
scripturaire, dans leur sentiment d’accomplir une mission, de répondre à une
vocation, et enfin dans leur commune aspiration à une thérapeutique par
l’écriture : elle veut « mettre des mots sur les maux » ; lui joue du rapprochement
des deux mots « médication/méditation », à la manière de Montaigne. Tous deux
sont incapables de sortir du stade esthétique, selon les mots du philosophe danois,
évoqué comiquement dans la réponse de Victor à Sandrine : « Pourquoi désirer
(le bonheur), puisque c’est la mort des possibles ? » Réponse philosophique à une
question prosaïque. Dans leur récit, tout est possible, tout est permis : à la fois le
« lyrisme pyrotechnique » de Victor : chaque nom de ses conquêtes – Margaux,
Clémence, (en licence), Aude, Léa, Lou, Clélie, Chiara, Amélie, Jessica – s’inscrit
dans une constellation littéraire et poétique, qui ressuscite, dans la « nécropole labyrinthe » de Paris, les Muses et les poètes d’antan, comme les noms
d’« Abbesses », « Petites Maisons », « Castiglione », constituent des rappels d’un
temps où femmes et hommes, à la Cour et dans l’Église, habitaient un
commun royaume, avant que le « trône (ne fût) renversé ». Il multiplie, pour
séduire le lecteur, les références en creux à la poésie et à la littérature, au Jardin
des Lettres où circulent, comme au « Père Lachaise », Pascal, Casanova, Barbey,
Nerval, Baudelaire, Apollinaire, Queneau et Stendhal. Maé, avec ses
tics langagiers, ses automatismes (« mon petit Frago », « un pseudo pour l’asso »),
sa soumission à la mode des adjectifs en écho (« curatif », « préventif »,
« réceptif »), plante dans ce jardin des fleurs nouvelles, au parfum plus capiteux,
mais non moins envoûtant. De ce jardin aussi, le féminisme l’exile. La littérature
rapatrie les femmes dans son monde : puisque le Journal côtoie le Carnet, que le
journal fait sienne la proclamation esthétique du carnet : « Je prescrivis le feu et
proscrivis l’ennui », et que la conversion à la littérature suture la faille entre les
sexes.
Ainsi n’a-t-on plus affaire à la seule guerre asymétrique des sexes : la fiction est
un remède au mal, puisque, dans le roman, les deux sexes rivalisent d’invention et
de science pour séduire et enchanter le lecteur dans des registres complémentaires
et opposés, selon les règles antiques du delectare. Maé Bavoir, par son invention,
ses aveux, sa franchise, devient une féministe malgré elle, aussi sympathique que
pathétique, puisqu’elle fait vibrer toutes les cordes de la langue, capable qu’elle
est non seulement « d’ouvrir les oreilles, d’ouvrir sa bouche » mais aussi de
s’inscrire dans la grande tradition satirique et romanesque, lyrique et
mélancolique de « Victor, sol Invictus, victus ». Le Jardin des femmes perdues a
le parfum de L’Art d’aimer d’Ovide, du Satyricon de Pétrone et de la Recherche
de Proust.

Orphée et Eurydice aux enfers
Dans les rues de Paris, le grand cortège des fiertés ondulait comme un serpent multicolore. Des bannières arc-en-ciel flottaient dans l’air chargé d’électricité, de cris. C’étaient des hurlements de fête que la chaleur et l’alcool avaient rendus hostiles. En empruntant la rue Saint-Martin, Orphée croisa la horde tapageuse, rasa les immeubles, évita le heurt des corps. Soudain, au milieu de cette cohorte hurlante et enfiévrée, un minois d’une fraîcheur exquise attira son regard. C’était une frêle demoiselle dont la douceur infinie offrait un saisissant contraste avec la meute brutale, et qui défilait d’un air impassible et souverain. Tout à coup, une grimace altéra son visage : déjà elle se penchait sur son talon meurtri où perlait une goutte de sang. Au sol, une Heineken brisée faisait miroiter ses crocs : ils venaient de déchirer la sandale de la promeneuse.
Des bacchantes aux cheveux roses et bleus se pressèrent autour d’Eurydice qui saignait abondamment et lui firent un bandage sommaire. Sa grande sœur l’accompagna jusqu’à la station Rambuteau : l’hôpital Saint-Louis n’était qu’à trois arrêts de là. Elles descendirent les escaliers souterrains, s’engouffrèrent dans la bouche du métro parisien. Orphée les suivit, monta à l’intérieur de la rame. C’est alors qu’Eurydice le remarqua, qu’elle posa un long moment ses yeux sur lui. Station Goncourt, elles prirent le chemin des urgences, déclinèrent leur identité, s’assirent dans une salle bondée.
– Laisse-moi seule, dit Eurydice, tu en as déjà fait beaucoup… On se verra demain…
– Tu plaisantes, little sister ! La Pride arrive à Répu ! Je rejoins les filles et puis on vient te chercher ! Après ton pansement, on fait la teuf toute la nuit !
En sortant, l’aînée remarqua Orphée qui franchissait le sas de l’hôpital. Il avait aperçu Eurydice qui venait d’entrer dans une salle obscure et la suivit à l’intérieur. Sur le seuil, une infirmière à l’allure sévère lui demanda ce qu’il voulait. Il expliqua qu’il connaissait la jeune patiente blessée au pied. L’intransigeante gardienne fronça d’abord les sourcils puis le laissa passer. Il y avait dans la voix du visiteur un charme magique qui semblait pouvoir ouvrir tous les cœurs et toutes les portes. Elle expliqua qu’elle devait s’occuper d’un autre patient mais qu’elle allait bientôt revenir. Orphée s’approcha d’Eurydice, se pencha vers son oreille :
– Je vous ai vue, dit-il, je vous ai suivie.
– Je sais.
– Sortons, je vous soignerai chez moi, votre blessure n’est pas profonde. Ce lieu est infernal…Vous y attendrez une éternité…
– Êtes-vous médecin ?
– Je sais l’art d’apaiser les souffrances.
Elle ferma les yeux un instant, se laissant griser par une voix familière qui semblait l’enchanter depuis toujours. Elle se leva.
– Marchez devant ! lui dit-elle, ma sœur ne devrait pas tarder, elle ne me laisserait pas partir toute seule… avec un homme !
Il la précéda, sentait contre sa nuque le souffle de sa promise qui le talonnait en boitillant. Parvenu au seuil de la porte, il se retourna vers elle et lui jeta un regard dans lequel se révélait au jour une tendresse infinie. Alors, la tonitruante protectrice surgit de nulle part et reconnut l’intrus. C’était l’homme du métro, celui qui les avait suivies, celui que sa sœur avait un peu trop longtemps regardé. Elle beugla :
– Tu veux quoi, toi, casse-toi !
Puis, sortant sur le parvis de l’hôpital où attendaient les autres :
– Les filles, faut donner une leçon à ce connard, il est venu agresser ma sister aux urgences !
Comme un seul homme, une demi-douzaine de Ménades se jetèrent sur lui, irisées par les couleurs de l’arc-en-ciel, hystérisées par la fièvre. Ce furent des griffures et des morsures, des coups de pied et des coups de poing. Rendues furieuses par les vapeurs de la bière et du vin, elles le laissèrent à moitié mort sur le pavé, en entonnant des refrains bachiques.
– Allons faire la fête ! firent-elles à Eurydice en l’empoignant violemment.